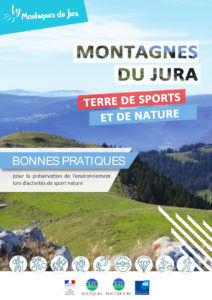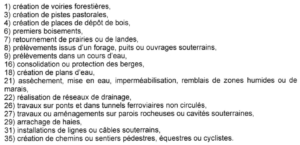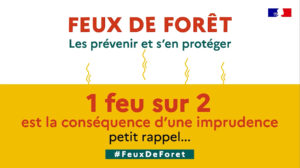Ce printemps : Inventaires des amphibiens des mares de la Petite Montagne
Les mares (et autres petits points d’eau permanentes ou temporaires) présentes sur le territoire du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura constituent un réseau d’habitats favorables pour nos amis les amphibiens. Parmi eux, deux espèces d’intérêt communautaire, protégées et emblématiques du territoire sont présentes :
– Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
– Le Triton crêté (Triturus cristatus)
Cependant comme de nombreux amphibiens, ces deux espèces emblématiques sont en déclin en Franche-Comté, victimes de la fragmentation du paysage, de la perte d’habitat mais aussi des changements climatiques. Pour protéger les populations d’amphibiens, ainsi que l’ensemble de la biodiversité inféodée aux mares, il est indispensable de maintenir sur le territoire un réseau fonctionnel de mares interconnectées et de bonne qualité écologique.
- Comment réalise-t-on cet inventaire ?
Les prospections amphibiens se déroulent pendant la période de reproduction, qui s’étend de la fin de l’hiver jusqu’au milieu de l’été selon les espèces. Afin de détecter toutes les espèces, chaque mare est prospectée 3 fois à 3 périodes différentes, avec des passages en journée et de nuit après le coucher du soleil.
Pour cette année de suivi, les prospections concerneront la moitié nord du périmètre Natura 2000 Petite Montagne du Jura, sur les communes de : Beffia, Cernon, Chamberia, Charchilla, Chaveria, Coyron, Dompierre-sur-Mont, Ecrille, La Tour de Meix, Maisod, Marigna-sur-Valouse, Meussia, Onoz, orgelet, Plaisia, Sarrogna, Valzin en Petite Montagne.
- Quel sont les objectifs ?
Concrètement, ce travail permettra :
- D’actualiser et d’améliorer les connaissances sur les populations d’amphibiens du territoire, et notamment des espèces d’intérêt patrimonial.
- D’identifier des secteurs à enjeu prioritaire pour la préservation des espèces.
A terme, l’objectif de cette étude est d’améliorer la qualité écologique du réseau de mares présent sur le site, pour le maintien des communautés d’amphibiens et de l’ensemble de la biodiversité inféodée à ces milieux fragiles.
- Ce projet vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter au 03 84 48 85 15 ou par mail à [email protected]
Partager sur les réseaux sociaux :
La gazette du CBNFC est sortie !
Partager sur les réseaux sociaux :
Un bol d’air pour les milieux humides
D’après les photographies anciennes, le marais de la Mercantine, situé à Maisod, occupait autrefois près de 6 hectares. La construction du barrage de Vouglans et l’élévation du niveau de la rivière d’Ain ont causé la disparition de près de 70% de cette surface par immersion. Suite à la déprise de ces terres ainsi rendues difficiles d’accès, la forêt (notamment les pins) n’a cessé de gagner du terrain sur les habitats ouverts humides. La conservation des espèces associées, pour certaines fortement patrimoniales (Grassette commune, Orchis odorant), s’en trouvait menacée et l’on pouvait prédire leur disparition du site si l’embroussaillement à l’œuvre n’était pas freiné.
C’est pour ces raisons que les acteurs locaux – équipe Natura 2000 de Terre d’Emeraude Communauté, PNR du Haut-Jura, commune de Maisod, Office national des Forêts – ont œuvré pour que des travaux de réouverture des milieux soient mis en œuvre. Un chantier d’abattage des grands résineux (140 arbres) et de coupe de la strate arbustive s’est ainsi déroulé au cours du mois de février 2021. Le suivi naturaliste de la faune et de la flore dans les mois qui viennent permettra d’apprécier l’efficacité des travaux.

Partager sur les réseaux sociaux :
Focus sur la couleuvre vipérine
Les causes de régression de la couleuvre vipérine sont multiples. Néanmoins, la destruction et la fragmentation des habitats et des micro-habitats naturels supports de vie des reptiles arrivent en tête de liste. Les pratiques de gestion intensive, qui homogénéisent les paysages (notamment les opérations de tonte/fauche rases et répétées), limitent drastiquement les possibilités de développement des reptiles, tout comme la méconnaissance de cette espèce inoffensive, qui mène souvent à sa destruction.

Dans le cadre de son programme d’actions, la LPO Franche-Comté souhaite améliorer la connaissance de la répartition de l’espèce et mettre en place des mesures de conservation sur ses principales zones de présence. Les vallées de la Seille, du Suran, de la Valouse, de l’Ain, de la Bienne et leurs annexes hydrauliques hébergent en effet de belles stations de la couleuvre vipérine qu’il est primordial de préserver.
Qu’ils soient propriétaires ou gestionnaires de parcelles aux abords de ces cours d’eau, les collectivités (Département du Jura, communautés de communes, communes), les particuliers et EDF DPIH (ingénierie hydraulique) sont les principaux acteurs concernés.
La LPO Franche-Comté se tient à leur disposition (coordonnées ci-dessous) pour mettre en place une collaboration permettant de concilier au mieux les contraintes liées à leurs activités et la législation qui s’applique aux espèces protégées :
- Mieux connaître les risques de destruction d’individus et de leurs habitats lors des différentes activités (réfection de talus, de berges, opérations d’entretien courant).
- Mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion en définissant :
- les périodes d’intervention les moins impactantes (octobre pour les opérations lourdes impactant les sols ; décembre-janvier pour les entretiens de végétation),
- des protocoles spécifiques de suivi/sauvetage des reptiles en phase travaux.
Contact : Alix MICHON, LPO Franche-Comté / [email protected] / 03 81 50 59 53
Pour plus d’information :
Guide de détermination des serpents
Plaquette couleuvre vipérine
SOS serpents
Partager sur les réseaux sociaux :
Montagnes du Jura : terre de sports et de nature
La beauté des paysages, la nature préservée et le caractère authentique du territoire constituent les trois premiers éléments d’attractivité du Massif du Jura (chiffres clés du tourisme 2016 – Montagnes du Jura). Il existe donc un enjeu fort à préserver notre patrimoine, le valoriser et sensibiliser les visiteurs à sa préservation.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction régionale et départementale jeunesse, sport et cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté ont exprimé leur intérêt pour la création d’un livret pédagogique, favorisant le lien entre le visiteur (pratiquant d’activités de pleine nature, débutant ou expérimenté) et son environnement, ainsi que les paysages du Massif du Jura.
Les CPIE du Haut-Jura et du Haut-Doubs ont donc mis à profit leurs 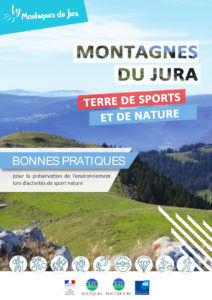 compétences en éducation à l’environnement, en interprétation et en édition pour développer un outil original, invitant chaque pratiquant à adapter et modifier ses pratiques pour mieux comprendre, contribuer et préserver l’environnement et nos paysages.
compétences en éducation à l’environnement, en interprétation et en édition pour développer un outil original, invitant chaque pratiquant à adapter et modifier ses pratiques pour mieux comprendre, contribuer et préserver l’environnement et nos paysages.
Cliquez sur l’image ci-contre pour obtenir la version dématérialisée du livret « MONTAGNES DU JURA, Terre de sports et de nature – Bonnes pratiques pour la préservation de l’environnement lors d’activités de sport nature » !
Partager sur les réseaux sociaux :
Évaluation des incidences Natura 2000 : zoom sur la 2ème liste locale
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
L’article L.414-4 du Code de l’environnement prévoit que certaines activités doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée « Évaluation des incidences Natura 2000 ».
L’évaluation des incidences est à la charge du maître d’ouvrage ou de l’organisateur. Celui-ci doit analyser les effets de son projet (temporaires ou permanents, directs ou indirects, et cumulés) et déterminer s’il portera atteinte aux habitats et espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
Les activités soumises à évaluation des incidences
Trois « listes positives » définissent les activités (documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions) soumises à évaluation des incidences Natura 2000 :
- une liste nationale (figurant à l’article R. 414-19 du code de l’environnement) ;
- une première liste locale/régionale (définie par l’arrêté préfectoral régional du 23 juin 2011) qui concerne les activités (autres que celles de la liste nationale) qui relèvent déjà d’un encadrement administratif (déclaration, autorisation…) ;
- une seconde liste locale/départementale (définie par l’arrêté préfectoral départemental du 18 juillet 2019) qui comprend des activités ne relevant d’aucun encadrement administratif (autrement appelé « régime propre »).
La réglementation prévoit également une disposition (dite clause « filet ») permettant au préfet de soumettre à évaluation d’incidence Natura 2000, par une décision motivée, une activité qui ne serait pas mentionnée dans une des trois listes mentionnées ci-dessus.
La seconde liste locale d’évaluation des incidences
Les 16 activités qui figurent dans la seconde liste locale du Jura (arrêté préfectoral n°39-2019-07-18-002 du 18/07/2019) ont été choisies par un groupe de travail animé par la Préfecture du Jura dans une liste nationale de référence comprenant 36 items (article R 414-27 du code de l’environnement) :
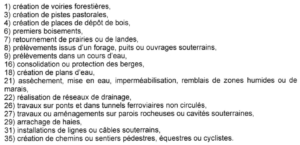
Le service Natura 2000 de la Communauté de Communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d’Orgelet se tient à votre disposition pour toute demande d’information concernant ce document.
N’hésitez pas, autour de vous, à informer les porteurs de projets concernés de l’existence de cet arrêté et à les inviter à prendre contact avec le service Natura 2000 pour toute demande de renseignements.
Pour plus d’information :
→ Site internet de la Direction départementale des territoires (DDT) du Jura
Partager sur les réseaux sociaux :
Feux de forêt : préservons la nature face aux incendies
 Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie est forte pour bon nombre d’entre nous de profiter du grand air avec ses proches.
Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie est forte pour bon nombre d’entre nous de profiter du grand air avec ses proches.
Il est cependant essentiel de faire preuve de vigilance et d’adopter de bons comportements afin d’éviter les départs de feux. Le risque concerne aussi bien les forêts que les autres zones naturelles comme les friches, les abords des champs, les landes, les bords de route, etc. L’ensemble de la végétation et de la faune peut être impacté.
La sécheresse de l’année dernière, combinée aux conditions météorologiques particulières de ces derniers mois (rafales de vent, peu de précipitations et températures en hausse) implique que les sols et la végétation sont très secs. Les espaces naturels pourraient s’enflammer rapidement.
Pour limiter le risque de départ de feu près de espaces naturels desséchés, il convient de respecter de bons comportements :
- ne pas faire usage de matériel provoquant des étincelles (débroussailleuse, disqueuse, meuleuse, poste à souder…),
- ne pas jeter de mégot par terre,
- ne pas faire de barbecue,
- ne pas stocker de combustibles près des maisons (bois de cheminée, peintures ou solvants, citernes de gaz ou de fuel).
Restez vigilants ! Ces comportements concernent aussi bien les riverains que les touristes.
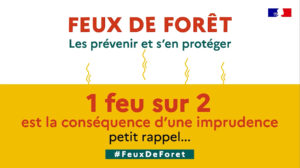
Lors d’un départ de feu, restez chez vous et contactez dans les plus brefs délais les services des pompiers (18) et des urgences (112 ou le 114 destiné aux personnes souffrant d’un handicap auditif). La préfecture met également à disposition des informations via son site ou un répondeur. Rappelons que plusieurs dizaines d’hectares de forêt ont déjà été incendiés en ce début de printemps, dans la zone à risque habituelle (Alpes Maritimes ou Bouches-du-Rhône) mais aussi dans des départements historiquement moins exposés comme en Charente, Haute-Loire, Sarthe, entre Vosges et Moselle.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
Partager sur les réseaux sociaux :
La forêt sous ordonnance ?
Les maladies, souvent dues à des organismes non autochtones, ont des conséquences importantes sur les milieux forestiers. L’exemple le plus marqué en Petite Montagne est la chalarose du frêne commun. Depuis quelques années, les épicéas subissent des attaques de scolytes qui dégradent rapidement l’état sanitaire des plantations.
L’intensification de la gestion forestière – par la plantation de résineux, la gestion en futaie régulière, les coupes rases ou les coupes précoces – a pour effet de diminuer la biodiversité en forêt. À l’inverse, la gestion de peuplements diversifiés, avec coupes étalées dans le temps, tend vers une productivité importante tout en maintenant la richesse biologique du milieu et son équilibre.

Partager sur les réseaux sociaux :
Lettre d’info 2020
Au sommaire de cette troisième lettre Natura 2000, vous trouverez des éléments d’information sur :
- le dispositif d’évaluation d’incidences Natura 2000,
- le stage 2021 concernant la présence de chauves-souris dans le bâti,
- les résultats des études sur les milieux forestiers et les petites chouettes de montagne,
- l’animation des MAEC et d’un groupe de travail « prairies et parcours ».

Bonne lecture !
Partager sur les réseaux sociaux :
L’œil des falaises
Un œil vous guette du haut des falaises, le chasseur cherche sa proie. Le Faucon pèlerin est prêt à fondre en piquets ultra rapides sur les oiseaux dont il se nourrit (généralement entre 150 et 250 km/h, pouvant aller jusqu’à 389 km/h).
La femelle pond 3 à 4 œufs en février-mars. Généralement, seuls un à deux jeunes arriveront à la maturité sexuelle 20 mois plus tard.
Toutes les falaises abritant la reproduction de l’espèce dans le Jura sont protégées par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

Partager sur les réseaux sociaux :